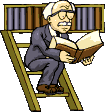|

|

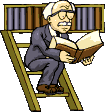
DÉSIR
ET PLAISIR
OU
MIEUX VAUT UNE TÊTE BIEN FAITE…
Je vais d’abord préciser quelque peu l’origine du désir, puis
nous verrons quelques exemples cliniques qui nous montreront l’importance
de désir, du plaisir et de la prise en compte du sujet
 Le désir se
distingue du besoin : besoin de nourriture, de téter au départ
pour l’enfant. La mère va interpréter les cris de l’enfant comme une
demande, c’est à dire un appel signifiant à la satisfaction. Si la
mère répond, c’est qu’elle suppose que, au-delà du cri, il y a la
demande de son enfant. En supposant cette demande elle implique l’enfant
dans le champ du langage et de la parole.
Le désir se
distingue du besoin : besoin de nourriture, de téter au départ
pour l’enfant. La mère va interpréter les cris de l’enfant comme une
demande, c’est à dire un appel signifiant à la satisfaction. Si la
mère répond, c’est qu’elle suppose que, au-delà du cri, il y a la
demande de son enfant. En supposant cette demande elle implique l’enfant
dans le champ du langage et de la parole.
 Lorsque la mère ne répond pas de suite, dans l’immédiateté,
il y a frustration pour l’enfant : la mère laisse place au manque
dans la satisfaction de la demande. Le désir advient alors au-delà
de la demande comme manque d’un objet. L’enfant se constitue alors
comme Sujet désirant. L’enfant accède au désir en isolant la cause
de sa satisfaction qui est l’objet cause de désir : le mamelon
de sa mère, et il ne le fait que s’il est frustré. Ensuite l’enfant
va se représenter sur un mode imaginaire cet objet supposé perdu.
Lorsque la mère ne répond pas de suite, dans l’immédiateté,
il y a frustration pour l’enfant : la mère laisse place au manque
dans la satisfaction de la demande. Le désir advient alors au-delà
de la demande comme manque d’un objet. L’enfant se constitue alors
comme Sujet désirant. L’enfant accède au désir en isolant la cause
de sa satisfaction qui est l’objet cause de désir : le mamelon
de sa mère, et il ne le fait que s’il est frustré. Ensuite l’enfant
va se représenter sur un mode imaginaire cet objet supposé perdu.
 Nous allons voir quelques exemples qui illustrent la
prise en compte unique de la physiologie dans les troubles sexuels,
puis nous en tirerons quelques réflexions sur le désir et le plaisir.
Nous allons voir quelques exemples qui illustrent la
prise en compte unique de la physiologie dans les troubles sexuels,
puis nous en tirerons quelques réflexions sur le désir et le plaisir.
 Monsieur B est allé consulter, seul, dans un important
centre hospitalier. Un bilan fut aussitôt entrepris. Les érectographies
nocturnes étant douteuses, on décida d’approfondir le bilan par une
cavernographie et une débimètrie, ce qui permit de mettre en évidence
une fuite veineuse. L’indication d’une cure chirurgicale par plicature
veineuse fut posée. Mais cela ne donna pas de résultats satisfaisants,
aussi Monsieur B subit-il une deuxième intervention par pontage artériel
afin d’augmenter l’apport sanguin. Ensuite les mesures de débits furent
satisfaisantes. Malheureusement lui-même et son amie, n’étant pas
sensibles aux courbes de débits, ne se trouvèrent pas satisfaits :
si, du fait de l’apport sanguin important, la verge lui paraissait
plus importante qu’avant au repos, la réalisation de l’érection était
encore bien chancelante avec en plus une éjaculation qui survenait
trop prématurément. On lui proposa alors de rencontrer quelqu’un de
l’ordre des «psy ». Monsieur B se présente comme un anxieux,
hypomaniaque, ayant toujours peur de ne pas
arriver dans tout ce qu’il entreprend, et se précipitant dans
une activité avec empressement afin de ne pas prolonger l’angoisse
de ne pas y arriver ou en s’enfuyant de cette activité. Il ne peut
exprimer ce qu’il ressent, sa tendresse, et agit pour lui-même, pas
pour l ‘autre. Son amie vit dans le souvenir de son ancien mari
parti, partenaire idéalisé, elle vit en montrant l'attente de son
retour : la brosse à dent
de l’ex-mari est toujours dans la salle de bain, monsieur B
n’a pas le droit d’y toucher, encore moins de l’enlever alors que
pour lui elle tient toute la place ! Pour elle, l’amour est idéalisé,
elle l’a connu avec son mari, en dehors de lui cela ne peut exister
et cela lui est réservé. Avec son ami, monsieur B, elle parle plutôt
de tendresse, d’attentions qu’elle attend et qu’elle ne peut recevoir
du fait de sa précipitation en tout. Ce premier exemple montre que
s’il existait une pathologie vasculaire, une autre dimension était
délaissée et prise en compte en dernier alors qu’elle était primordiale
si on voulait espérer une résolution du symptôme sexuel et une satisfaction
des partenaires. Nous voyons par eux que ce symptôme sexuel renvoie
à une pathologie individuelle affective, psychique, et à une pathologie
du couple qui complète la pathologie individuelle et qui est nourrie
par elle.
Monsieur B est allé consulter, seul, dans un important
centre hospitalier. Un bilan fut aussitôt entrepris. Les érectographies
nocturnes étant douteuses, on décida d’approfondir le bilan par une
cavernographie et une débimètrie, ce qui permit de mettre en évidence
une fuite veineuse. L’indication d’une cure chirurgicale par plicature
veineuse fut posée. Mais cela ne donna pas de résultats satisfaisants,
aussi Monsieur B subit-il une deuxième intervention par pontage artériel
afin d’augmenter l’apport sanguin. Ensuite les mesures de débits furent
satisfaisantes. Malheureusement lui-même et son amie, n’étant pas
sensibles aux courbes de débits, ne se trouvèrent pas satisfaits :
si, du fait de l’apport sanguin important, la verge lui paraissait
plus importante qu’avant au repos, la réalisation de l’érection était
encore bien chancelante avec en plus une éjaculation qui survenait
trop prématurément. On lui proposa alors de rencontrer quelqu’un de
l’ordre des «psy ». Monsieur B se présente comme un anxieux,
hypomaniaque, ayant toujours peur de ne pas
arriver dans tout ce qu’il entreprend, et se précipitant dans
une activité avec empressement afin de ne pas prolonger l’angoisse
de ne pas y arriver ou en s’enfuyant de cette activité. Il ne peut
exprimer ce qu’il ressent, sa tendresse, et agit pour lui-même, pas
pour l ‘autre. Son amie vit dans le souvenir de son ancien mari
parti, partenaire idéalisé, elle vit en montrant l'attente de son
retour : la brosse à dent
de l’ex-mari est toujours dans la salle de bain, monsieur B
n’a pas le droit d’y toucher, encore moins de l’enlever alors que
pour lui elle tient toute la place ! Pour elle, l’amour est idéalisé,
elle l’a connu avec son mari, en dehors de lui cela ne peut exister
et cela lui est réservé. Avec son ami, monsieur B, elle parle plutôt
de tendresse, d’attentions qu’elle attend et qu’elle ne peut recevoir
du fait de sa précipitation en tout. Ce premier exemple montre que
s’il existait une pathologie vasculaire, une autre dimension était
délaissée et prise en compte en dernier alors qu’elle était primordiale
si on voulait espérer une résolution du symptôme sexuel et une satisfaction
des partenaires. Nous voyons par eux que ce symptôme sexuel renvoie
à une pathologie individuelle affective, psychique, et à une pathologie
du couple qui complète la pathologie individuelle et qui est nourrie
par elle.
 Le deuxième exemple est celui de Monsieur C. Monsieur
C est éjaculateur précoce. Il est sorti très tôt avec sa femme et
n’a jamais eu d ‘autres expériences sexuelles. Cette éjaculation
prématurée s’aggrave et devient «ante portas ». Il a déjà consulté
de nombreux médecins et fut souvent éconduit à travers des paroles
pseudo rassurantes : « ça s’arrangera avec l’âge »
et subit même une opération pour un pseudo phimosis. Dernièrement
on lui a donné un traitement par des alpha bloquants qui ralentissent
la phase sécrétoire de l’éjaculation. Mais sans résultats. On note
chez monsieur C une anxiété très ancienne qui se traduit par une certaine
précipitation en tout ce qu’il entreprend. Évidemment cette anxiété
se traduit à chaque rapport sexuel par une peur de l’échec qui précipite
les choses, et, pour ne pas ressentir l’insatisfaction qui en découle,
il préfère éviter toute relation avec sa femme, même au niveau des
gestes tendres. Celle-ci se présente comme une personne elle aussi
insécurisée, septique en tout, et principalement sur l’évolution de
cette éjaculation précoce, sur la rapidité de son mari. Elle pense
le quitter, à lui de faire la preuve. Cette épée de Damoclès est loin
d’être rassurante pour le mari et cela peut se traduire par des épisodes
d’impuissance. L’enfance de Monsieur C a été marquée par une mésentente
des parents. Jusqu’à l’âge de 14 ans il a dormi dans la chambre des
parents. Au début il disait n’avoir aucun souvenir conscient de ces
nuits, puis parla de ces nuits difficiles où il se sentait mal à l’aise,
dormait mal, enfin il put décrire les relations nocturnes de ses parents,
relations continuant l’agressivité de la journée, relations vécues
dans la rapidité la mère
demandant au père de faire cesser rapidement ce jeu et chacun s’y
employant. Nous voyons à travers cet exemple que le symptôme sexuel
est au départ le signe de difficultés personnelles en rapport avec
l’enfance et que par la suite il signifiait aussi la peur de l’échec
ainsi que des difficultés relationnelles et affectives du couple.
On conçoit bien que les
alpha bloquants ne pouvaient à eux seuls débloquer la situation car
ils ne pouvaient par eux-mêmes permettre la perlaboration d’une parole
non dite, donner sens au symptôme.
Le deuxième exemple est celui de Monsieur C. Monsieur
C est éjaculateur précoce. Il est sorti très tôt avec sa femme et
n’a jamais eu d ‘autres expériences sexuelles. Cette éjaculation
prématurée s’aggrave et devient «ante portas ». Il a déjà consulté
de nombreux médecins et fut souvent éconduit à travers des paroles
pseudo rassurantes : « ça s’arrangera avec l’âge »
et subit même une opération pour un pseudo phimosis. Dernièrement
on lui a donné un traitement par des alpha bloquants qui ralentissent
la phase sécrétoire de l’éjaculation. Mais sans résultats. On note
chez monsieur C une anxiété très ancienne qui se traduit par une certaine
précipitation en tout ce qu’il entreprend. Évidemment cette anxiété
se traduit à chaque rapport sexuel par une peur de l’échec qui précipite
les choses, et, pour ne pas ressentir l’insatisfaction qui en découle,
il préfère éviter toute relation avec sa femme, même au niveau des
gestes tendres. Celle-ci se présente comme une personne elle aussi
insécurisée, septique en tout, et principalement sur l’évolution de
cette éjaculation précoce, sur la rapidité de son mari. Elle pense
le quitter, à lui de faire la preuve. Cette épée de Damoclès est loin
d’être rassurante pour le mari et cela peut se traduire par des épisodes
d’impuissance. L’enfance de Monsieur C a été marquée par une mésentente
des parents. Jusqu’à l’âge de 14 ans il a dormi dans la chambre des
parents. Au début il disait n’avoir aucun souvenir conscient de ces
nuits, puis parla de ces nuits difficiles où il se sentait mal à l’aise,
dormait mal, enfin il put décrire les relations nocturnes de ses parents,
relations continuant l’agressivité de la journée, relations vécues
dans la rapidité la mère
demandant au père de faire cesser rapidement ce jeu et chacun s’y
employant. Nous voyons à travers cet exemple que le symptôme sexuel
est au départ le signe de difficultés personnelles en rapport avec
l’enfance et que par la suite il signifiait aussi la peur de l’échec
ainsi que des difficultés relationnelles et affectives du couple.
On conçoit bien que les
alpha bloquants ne pouvaient à eux seuls débloquer la situation car
ils ne pouvaient par eux-mêmes permettre la perlaboration d’une parole
non dite, donner sens au symptôme.
 Enfin je voudrais citer l’exemple de Madame M qui se
plaint d’anorgasmie et d’anaphrodisie. Elle veut faire quelque chose
pour cela car son mari l’a trompée, elle a peur qu’il parte, il a
parlé de divorce alors qu’ils ont construit dit-elle. En fait, on
retrouve d’autres symptômes sexuels au début de leur vie commune,
ce qui correspond pour elle aux premières relations : à l’époque
elle présentait un vaginisme qui fut traité malheureusement de façon
purement comportementale par des dilatations vaginales à l’aide de
bougies. Je dis malheureusement car c’est un traitement appliqué fréquemment
et quelques années plus
tard on revoit ces femmes parce que, comme dans le cas de madame M,
elles présentent alors une anorgasmie, une anaphrodisie ou elles ont
des épisodes répétitifs de symptomatologie dépressive. Madame M se
présente comme une personne inhibée, introvertie, complexée physiquement.
Elle dit qu’elle n’a jamais tenu en estime les hommes et qu’un homme
ne peut rien lui apporter. Elle est enfant unique ; unique accident
car son père ne voulait pas d’enfant. Il ne s’est jamais occupé d’elle
et sa mère. Préfèrant son travail à son enfant, l’a laissée chez sa
grand-mère jusqu’à l’âge de 12 ans. Le grand-père était alors en hôpital
psychiatrique car il était délirant. Nous comprenons facilement quelle
image madame M peut avoir des hommes, hommes inexistants dans les
premières années de sa vie, et du peu qu’elle en attend. Un substitut
phallique comme des bougies est certes insuffisant pour modifier la
représentation qu’elle a des hommes et son attente vis à vis d’eux.
Enfin je voudrais citer l’exemple de Madame M qui se
plaint d’anorgasmie et d’anaphrodisie. Elle veut faire quelque chose
pour cela car son mari l’a trompée, elle a peur qu’il parte, il a
parlé de divorce alors qu’ils ont construit dit-elle. En fait, on
retrouve d’autres symptômes sexuels au début de leur vie commune,
ce qui correspond pour elle aux premières relations : à l’époque
elle présentait un vaginisme qui fut traité malheureusement de façon
purement comportementale par des dilatations vaginales à l’aide de
bougies. Je dis malheureusement car c’est un traitement appliqué fréquemment
et quelques années plus
tard on revoit ces femmes parce que, comme dans le cas de madame M,
elles présentent alors une anorgasmie, une anaphrodisie ou elles ont
des épisodes répétitifs de symptomatologie dépressive. Madame M se
présente comme une personne inhibée, introvertie, complexée physiquement.
Elle dit qu’elle n’a jamais tenu en estime les hommes et qu’un homme
ne peut rien lui apporter. Elle est enfant unique ; unique accident
car son père ne voulait pas d’enfant. Il ne s’est jamais occupé d’elle
et sa mère. Préfèrant son travail à son enfant, l’a laissée chez sa
grand-mère jusqu’à l’âge de 12 ans. Le grand-père était alors en hôpital
psychiatrique car il était délirant. Nous comprenons facilement quelle
image madame M peut avoir des hommes, hommes inexistants dans les
premières années de sa vie, et du peu qu’elle en attend. Un substitut
phallique comme des bougies est certes insuffisant pour modifier la
représentation qu’elle a des hommes et son attente vis à vis d’eux.
 Ces quelques exemples montrent que le symptôme sexuel
renvoie à autre chose qu’une fonction purement physiologique. Les résultats
des analyses et des explorations fonctionnelles peuvent être bons
et même plus que bons, et la réalisation sexuelle du patient négative.
Cela nous montre bien que dans un trouble sexuel, si la physiologie
peut intervenir, il existe aussi autre chose qui est mise en jeu. Ceci
peut être indépendant de l’atteinte organique ; c’est-à-dire que
nous nous trouvons en face de 2
pathologies juxtaposées : pathologie somatique et pathologie
psychologique. Traiter l’une sans s’occuper de l’autre mène à une
impasse. Mais il peut y avoir relation avec l’atteinte organique.
En effet un trouble sexuel d’origine somatique ne laisse pas indifférent
la personne qui en est atteinte ainsi que son ou sa partenaire. C’est
une blessure narcissique avec sentiment de dévalorisation et parfois
symptomatologie dépressive. Cela peut s’entendre dans : " je
ne suis plus un homme ", "je ne suis plus une femme ",
"je ne suis plus bon à rien ", "que reste-t-il
s’il n’y a même plus cela ? ". Alors, outre la correction
organique, nous devons aussi restaurer l’image de soi de la personne
sinon la symptomatologie dépressive demeurera, avec la perte de l’intérêt
sexuel, parfois des conduites d’échec ou bien l’anxiété inhibera la
relation sexuelle.
Ces quelques exemples montrent que le symptôme sexuel
renvoie à autre chose qu’une fonction purement physiologique. Les résultats
des analyses et des explorations fonctionnelles peuvent être bons
et même plus que bons, et la réalisation sexuelle du patient négative.
Cela nous montre bien que dans un trouble sexuel, si la physiologie
peut intervenir, il existe aussi autre chose qui est mise en jeu. Ceci
peut être indépendant de l’atteinte organique ; c’est-à-dire que
nous nous trouvons en face de 2
pathologies juxtaposées : pathologie somatique et pathologie
psychologique. Traiter l’une sans s’occuper de l’autre mène à une
impasse. Mais il peut y avoir relation avec l’atteinte organique.
En effet un trouble sexuel d’origine somatique ne laisse pas indifférent
la personne qui en est atteinte ainsi que son ou sa partenaire. C’est
une blessure narcissique avec sentiment de dévalorisation et parfois
symptomatologie dépressive. Cela peut s’entendre dans : " je
ne suis plus un homme ", "je ne suis plus une femme ",
"je ne suis plus bon à rien ", "que reste-t-il
s’il n’y a même plus cela ? ". Alors, outre la correction
organique, nous devons aussi restaurer l’image de soi de la personne
sinon la symptomatologie dépressive demeurera, avec la perte de l’intérêt
sexuel, parfois des conduites d’échec ou bien l’anxiété inhibera la
relation sexuelle.
C’est
pourquoi je vais essayer de parler un peu du plaisir, ce qui renvoie
au désir, à la satisfaction, à la pulsion.
 Le plaisir apparaît très tôt comme une demande de la
mère : « pour faire plaisir à maman ». Mais en fait,
derrière cette demande de plaisir, il y a caché une demande toute
autre : une demande de différer le plaisir que l’on peut entendre
dans «ne fait pas cela » ou fait ceci pour ne pas faire cela ».
Différer ce plaisir pour ? Pour un avenir douillet. L’enfant
est alors confronté au désir de la mère et non plus seulement à son
propre désir. Il peut y avoir confusion (la demande de la mère est
prise au sérieux) et nous tombons dans la plus habituelle des structurations :
la névrose. Le névrosé est celui qui prend la demande de l’autre pour
son désir à lui, alors que le sujet normal désir en son nom. Le sujet
normal ne veut pas quelque chose parce qu’il déclare que cette chose
est désirable : nous serions alors au niveau de la perversion
(le pervers fait disparaître la subjectivité du je). Il ne veut pas
non plus quelque chose pour maman ou parfois pour papa comme le névrosé.
Le sujet normal veut. Il veut quelque chose, pour lui. Il le sait.
Mais il ne sait pas quoi. Il a un désir disponible. Si l’objet est
cause du désir par le manque, l’objet ne détermine pas un désir, il
lui est antérieur. Un désir peut se fixer à n’importe quoi, à n’importe
qui, parfois même à un objet désirable parce que, sachant qu’on est
désirant, on s’est aperçu que certains objets sont plus à même que
d’autres de satisfaire ce désir.
Le plaisir apparaît très tôt comme une demande de la
mère : « pour faire plaisir à maman ». Mais en fait,
derrière cette demande de plaisir, il y a caché une demande toute
autre : une demande de différer le plaisir que l’on peut entendre
dans «ne fait pas cela » ou fait ceci pour ne pas faire cela ».
Différer ce plaisir pour ? Pour un avenir douillet. L’enfant
est alors confronté au désir de la mère et non plus seulement à son
propre désir. Il peut y avoir confusion (la demande de la mère est
prise au sérieux) et nous tombons dans la plus habituelle des structurations :
la névrose. Le névrosé est celui qui prend la demande de l’autre pour
son désir à lui, alors que le sujet normal désir en son nom. Le sujet
normal ne veut pas quelque chose parce qu’il déclare que cette chose
est désirable : nous serions alors au niveau de la perversion
(le pervers fait disparaître la subjectivité du je). Il ne veut pas
non plus quelque chose pour maman ou parfois pour papa comme le névrosé.
Le sujet normal veut. Il veut quelque chose, pour lui. Il le sait.
Mais il ne sait pas quoi. Il a un désir disponible. Si l’objet est
cause du désir par le manque, l’objet ne détermine pas un désir, il
lui est antérieur. Un désir peut se fixer à n’importe quoi, à n’importe
qui, parfois même à un objet désirable parce que, sachant qu’on est
désirant, on s’est aperçu que certains objets sont plus à même que
d’autres de satisfaire ce désir.
 Ce n’est qu’après avoir accédé à l’objet d’un désir
qu’on repère une déception ou une satisfaction. La satisfaction montre
que ce désir était un désir en son nom, un désir du sujet désirant.
La déception, elle, met en évidence qu’on a perdu un désir que l’on
croyait avoir : en effet ce n’était pas un désir mais la demande
d’autrui, ce qui, bien sûr, ne peut pas apporter au sujet un sentiment
de satisfaction.
Ce n’est qu’après avoir accédé à l’objet d’un désir
qu’on repère une déception ou une satisfaction. La satisfaction montre
que ce désir était un désir en son nom, un désir du sujet désirant.
La déception, elle, met en évidence qu’on a perdu un désir que l’on
croyait avoir : en effet ce n’était pas un désir mais la demande
d’autrui, ce qui, bien sûr, ne peut pas apporter au sujet un sentiment
de satisfaction.
 Pour Freud l’organisme est dans un état de tension
qui est source de pulsion. Le plaisir est la satisfaction de la pulsion,
c’est à dire la réalisation
du but de la pulsion qui est de supprimer cet état de tension.
Un désir sexuel est un état de tension qui va chercher à se résoudre
avec l’orgasme qui procure une résolution de la tension. Tout organisme
vivant est dans un état de tension. La résolution totale de cet état
ne se fera que dans la mort, «au-delà du principe de plaisir ».
Le plaisir immédiat est différé pour un «plus
de jouir ». L’état de tension est soutenu par le principe
de réalité dans l’espoir que ce retard permettra plus de plaisir.
C’est ainsi que nous retrouvons le rôle de la mère interdictrice du
plaisir immédiat dans «pour faire plaisir à maman » afin d’accéder
à un surcroît de plaisir. Sexualité et mort sont liées. Cela explique
pourquoi la médecine se méfie de la recherche du plaisir car c’est
une voie qui peut conduire à la mort, alors que la médecine a pour
ambition de prolonger cette voie et d’éviter que l’organisme trouve
une voie courte, rapide, pour résoudre cette tension, surtout quand
elle est intense comme dans les maladies aiguës.
Pour Freud l’organisme est dans un état de tension
qui est source de pulsion. Le plaisir est la satisfaction de la pulsion,
c’est à dire la réalisation
du but de la pulsion qui est de supprimer cet état de tension.
Un désir sexuel est un état de tension qui va chercher à se résoudre
avec l’orgasme qui procure une résolution de la tension. Tout organisme
vivant est dans un état de tension. La résolution totale de cet état
ne se fera que dans la mort, «au-delà du principe de plaisir ».
Le plaisir immédiat est différé pour un «plus
de jouir ». L’état de tension est soutenu par le principe
de réalité dans l’espoir que ce retard permettra plus de plaisir.
C’est ainsi que nous retrouvons le rôle de la mère interdictrice du
plaisir immédiat dans «pour faire plaisir à maman » afin d’accéder
à un surcroît de plaisir. Sexualité et mort sont liées. Cela explique
pourquoi la médecine se méfie de la recherche du plaisir car c’est
une voie qui peut conduire à la mort, alors que la médecine a pour
ambition de prolonger cette voie et d’éviter que l’organisme trouve
une voie courte, rapide, pour résoudre cette tension, surtout quand
elle est intense comme dans les maladies aiguës.
 Cette méfiance de la médecine vis à vis du plaisir
s’illustre bien a ses prescriptions ; la nourriture médicalisée
n’est jamais agréable de peur qu’on en abuse et qu’on
en crève comme dans «la Grande Bouffe » de Marco Ferreri,
cette méfiance s’illustre aussi dans l’attitude vis à vis des toxicomanes
qui recherchent du plaisir, des personnes qui ont attrapé des «maladies
honteuses ». Ce soupçon de la médecine envers la recherche du
plaisir se retrouve aussi dans les curetages effectués plus ou moins
agressivement comme si on voulait donner une bonne leçon afin qu’elle
ne recommence pas à rechercher du plaisir. D’ailleurs lorsqu’il y
a viol, suivant qu’on suppose qu’il y a eu participation ou non de
la victime au plaisir, l’attitude sera différente. Cette méfiance
vis à vis du plaisir dans le champ médical se retrouve dans les médias.
Qu’on pense au ton réjoui et dogmatique pour annoncer que x personnes
sont mortes alors qu’elles avaient pris du Viagra dans les jours ou
semaines précédentes. En revanche on n’annonce pas combien de personnes
sont mortes alors qu’elles avaient, dans les jours précédents, mangé
des petits pois ou s’étaient mises les doigts dans le nez. Enfin cette
méfiance de la médecine vis à vis du plaisir se retrouve dans nos
exemples qui montrent que la technique médicale pure est incapable
de prendre en compte le plaisir qui se place au-delà de la physiologie.
Cette méfiance de la médecine vis à vis du plaisir
s’illustre bien a ses prescriptions ; la nourriture médicalisée
n’est jamais agréable de peur qu’on en abuse et qu’on
en crève comme dans «la Grande Bouffe » de Marco Ferreri,
cette méfiance s’illustre aussi dans l’attitude vis à vis des toxicomanes
qui recherchent du plaisir, des personnes qui ont attrapé des «maladies
honteuses ». Ce soupçon de la médecine envers la recherche du
plaisir se retrouve aussi dans les curetages effectués plus ou moins
agressivement comme si on voulait donner une bonne leçon afin qu’elle
ne recommence pas à rechercher du plaisir. D’ailleurs lorsqu’il y
a viol, suivant qu’on suppose qu’il y a eu participation ou non de
la victime au plaisir, l’attitude sera différente. Cette méfiance
vis à vis du plaisir dans le champ médical se retrouve dans les médias.
Qu’on pense au ton réjoui et dogmatique pour annoncer que x personnes
sont mortes alors qu’elles avaient pris du Viagra dans les jours ou
semaines précédentes. En revanche on n’annonce pas combien de personnes
sont mortes alors qu’elles avaient, dans les jours précédents, mangé
des petits pois ou s’étaient mises les doigts dans le nez. Enfin cette
méfiance de la médecine vis à vis du plaisir se retrouve dans nos
exemples qui montrent que la technique médicale pure est incapable
de prendre en compte le plaisir qui se place au-delà de la physiologie.
 Nous avons donc vu que le plaisir était la satisfaction
d’une pulsion et que par là il y avait un lien entre la mort et la
sexualité. Cela se traduit dans le langage lorsqu’on dénomme l’orgasme
par «la petite mort ». Une personne qui a un désir, a un désir
d’objet pouvant satisfaire la pulsion. Mais dans un certain sens nous
pouvons dire qu’un désir est un ersatz du désir, le désir né d’un
manque fondamental, d’un objet irrémédiablement perdu, objet premier
et ultime du désir. Tout autre objet n’est qu’un objet substitutif,
qu’il soit sein, pénis, vagin… Un désir n’est que l’avatar du désir
et dans tout symptôme sexuel, qui n’est que la non réalisation d’un
désir, il faut y voir deux versants : le signal qui est une référence
somatique, il renvoie à quelque chose, et le signifiant qui renvoie
alors au sujet lui même.
Nous avons donc vu que le plaisir était la satisfaction
d’une pulsion et que par là il y avait un lien entre la mort et la
sexualité. Cela se traduit dans le langage lorsqu’on dénomme l’orgasme
par «la petite mort ». Une personne qui a un désir, a un désir
d’objet pouvant satisfaire la pulsion. Mais dans un certain sens nous
pouvons dire qu’un désir est un ersatz du désir, le désir né d’un
manque fondamental, d’un objet irrémédiablement perdu, objet premier
et ultime du désir. Tout autre objet n’est qu’un objet substitutif,
qu’il soit sein, pénis, vagin… Un désir n’est que l’avatar du désir
et dans tout symptôme sexuel, qui n’est que la non réalisation d’un
désir, il faut y voir deux versants : le signal qui est une référence
somatique, il renvoie à quelque chose, et le signifiant qui renvoie
alors au sujet lui même.
 Toute sexothérapie, puisque c’est le terme…étrange…Nous
connaissons l’ergothérapie : le traitement par le travail, la
musicothérapie : le traitement par la musique… La sexothérapie :
le traitement par le sexe ?… Cela rejoindrait la méprise :
ayez des orgasmes pour ne pas être névrosés, alors que c’est parce
qu’il y a névrose qu’il n’y a pas d’orgasme. Toute thérapie de symptôme
sexuel ne peut ignorer le sujet, ne peut faire l’économie du désir.
Les personnes viennent pour être satisfaites : elles n’ont que
faire des beaux résultats des examens. On pourra donner toutes les
hormones, augmenter les débits, prescrire les médicaments qu’on veut,
cela ne permettra pas à la personne aliénée à la demande de l’autre
de devenir sujet de son désir et donc d’accéder à la satisfaction.
Tout traitement d’un symptôme sexuel passe donc pour la personne par
un travail sur elle-même quelle que soit l’origine de ce symptôme.
Toute sexothérapie, puisque c’est le terme…étrange…Nous
connaissons l’ergothérapie : le traitement par le travail, la
musicothérapie : le traitement par la musique… La sexothérapie :
le traitement par le sexe ?… Cela rejoindrait la méprise :
ayez des orgasmes pour ne pas être névrosés, alors que c’est parce
qu’il y a névrose qu’il n’y a pas d’orgasme. Toute thérapie de symptôme
sexuel ne peut ignorer le sujet, ne peut faire l’économie du désir.
Les personnes viennent pour être satisfaites : elles n’ont que
faire des beaux résultats des examens. On pourra donner toutes les
hormones, augmenter les débits, prescrire les médicaments qu’on veut,
cela ne permettra pas à la personne aliénée à la demande de l’autre
de devenir sujet de son désir et donc d’accéder à la satisfaction.
Tout traitement d’un symptôme sexuel passe donc pour la personne par
un travail sur elle-même quelle que soit l’origine de ce symptôme.
Cela m’amène
à conclure en complétant le sous titre
de cet article
« mieux
vaut une tête bien faite qu’un zizi bien plein »
|